|
L'huitre
de
normandie :
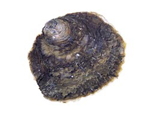 Au cours des siècles, une longue histoire d'amour a rapproché
les gastronomes et l'huître de Normandie.
Au cours des siècles, une longue histoire d'amour a rapproché
les gastronomes et l'huître de Normandie.
Déjà, au XVlie siècle, elle était
réputée à la cour de Louis XIV. La Normandie
possède en effet une bien réelle tradition huîtrière
de qualité, issue de la pêche côtière,
puis des cultures marines. A l'origine, les huîtres normandes
provenaient de la pêche côtière sur des gisements
naturels, en eau semi-profonde, soit de la baie de Granville-Cancale,
au cœur du golfe normand-breton, soit de la baie de Seine,
l'ancien " golfe du Calvados ".
Il s'agissait de l'huître plate, dénommée
" pied de cheval ", draguée avec des " fers
" par des navires superbes et fortement voilés,
les " bisquines ", sur les " huîtrières
" dont les noms évoquent encore un grand patrimoine
maritime.
Il faut citer en particulier les bancs du Haguet, de la Foraine,
du Trou à Giron, de la Costaise dans la baie de Granville-Chausey,
et ceux de Saint-Vaast-la-Hougue, de Grandcamp, de Courseulles
et de Port-en-Bessin, en baie de Seine.
Outre cette pêche en mer organisée en caravanes,
il faut mentionner une " industrie " ostréicole
à terre avec des claires d'engraissement et des ateliers
d'exploitation, qui assurait déjà la renommée
de l'huître de Normandie. Il suffit de découvrir
les tableaux de J.-F. de Troy dont le "Déjeuner aux
huîtres" et ceux, plus récents, de Guillaume
Fouace, de Morel-Facio ou d'Oscar Guet, et de lire ou relire Roger
Vercel et Jean Le Bot.
Avec le temps, dans les années 1960, après
un rude hiver, les Normands sont passés à la culture
des huîtres, l'ostréiculture des grandes marées,
en raison d'un estran sans fin et de marnages hors du commun,
de l'ordre de 14 mètres.
 Aujourd'hui, la Basse-Normandie, avec 40 000 tonnes d'huîtres
creuses, est devenue la première région conchylicole
française, avec quatre bassins de production sur la zone
de balancement des marées. Les huîtres d'élevage
de l'Ouest Cotentin-Chausey, de l'Est Cotentin - Saint-Vaast-la-Hougue,
de la baie des Veys-Grandcamp-Maisy et de la Côte de Nacre-Meuvaines-Asnelles
sont caractérisées par leur goût iodé,
unique et, dit-on, quelque peu aphrodisiaque, de plus en plus
apprécié par les amateurs éclairés.
Aujourd'hui, la Basse-Normandie, avec 40 000 tonnes d'huîtres
creuses, est devenue la première région conchylicole
française, avec quatre bassins de production sur la zone
de balancement des marées. Les huîtres d'élevage
de l'Ouest Cotentin-Chausey, de l'Est Cotentin - Saint-Vaast-la-Hougue,
de la baie des Veys-Grandcamp-Maisy et de la Côte de Nacre-Meuvaines-Asnelles
sont caractérisées par leur goût iodé,
unique et, dit-on, quelque peu aphrodisiaque, de plus en plus
apprécié par les amateurs éclairés.
Selon les bassins, ce goût caractéristique
de pleine mer et des grandes marées est plus ou moins prononcé
et il satisfait pleinement les grands gastronomes. Enfin, les
bases à terre et ateliers conchylicoles, nouveaux équipements,
tous aux normes sanitaires européennes, renforcent l'image
de qualité de l'huître de Normandie.
L'huître, merveille de nos réveillons, est
une nourriture plus qu'une autre magique : la nature a enfermé
dans une coquille nacrée cette délectable créature.
Celui qui l'ouvre redécouvre avec délices et, selon
l'idée que l'on s'en fait, avec sauvagerie ou avec raffinement
le plaisir délectable et quasi anthropophage de dévorer
la mer toute crue.
retour haut de page
La coquille saint jacques :
 La coquille Saint-Jacques est
un coquillage mythique lié à la mer. La Naissance
d'Aphrodite, statuette en terre cuite de la Grèce antique,
comme la Naissance de Vénus de Botticelli célèbrent
sa beauté. Elle sert encore d'insigne aux pèlerins
des longs chemins retrouvés du Mont-Saint-Michel, les Montois,
et à ceux de Saint-Jacques-de- Compostelle, les Jacquets.
La coquille Saint-Jacques est
un coquillage mythique lié à la mer. La Naissance
d'Aphrodite, statuette en terre cuite de la Grèce antique,
comme la Naissance de Vénus de Botticelli célèbrent
sa beauté. Elle sert encore d'insigne aux pèlerins
des longs chemins retrouvés du Mont-Saint-Michel, les Montois,
et à ceux de Saint-Jacques-de- Compostelle, les Jacquets.
C'est aussi une des rares espèces côtières
donnant lieu à des pêches qui la situent dans les
dix premières places au niveau national, en tonnage et
en valeur avec la reconnaissance récente d'un Label Rouge.
La coquille de la Manche Est - baie de Seine représente,
à elle seule,près de la moitié de la production
nationale. La côte qui va de Barfleur à Antifer occupe,
tant du point de vue géographique que productif, une situation
particuliére.Elle met en effet à la portée
des grands comme des petits bateaux artisanaux un gisement naturel
relativement riche.
L'attrait que provoque ce coquillage d'exception a necessité
l'organisation d'une exploitation rationnelle des gisements de
la pêcherie en Manche associant depuis 25 ans les pêcheurs
et leurs organisations professionnelles, aux scientifiques, avec
l'Ifremer et l'université de Caen, dans un double objectif
de conservation et de qualité. Ainsi les coquilles Saint-Jacques
en Normandie sont-elles pêchées à 11 centimètres
de diamètre, taille minimale de capture, assurant une reproduction
suivie chaque année par des bateaux océanographiques
qui évaluent le stock sur le fond et par des biologistes
spécialistes des ressources halieutiques. La conservation
de la pêcherie s'obtient progressivement par les caractéristiques
des flottilles,Les mesures echniques attachées aux engins
de pêche, et enfin par l'attribution de licences de pêche
définissant les quotas et périodes de pêche
(250 kilos par marin et par jour).
Grâce à ces efforts constants, "' les
malheureux qui vivent loin de la mer pourront très longtemps
encore se rendre en pèlerinage chez nous pour fêter
la saison de la Saint-Jacques singulière et délectable
créature que l'on servait autrefois couchée dans
sa coquille et noyée de beurre cachée sous une croute
de chapelure dorée.
retour
haut de page
La moule :
 Un récit publié à la fin du XVIème
siècle raconte qu'en 1235, un naufragé écossais,
Patrick Walton, vint s’échouer en baie d’Aiguillon
à une demi-lieue de port Esnande.
Un récit publié à la fin du XVIème
siècle raconte qu'en 1235, un naufragé écossais,
Patrick Walton, vint s’échouer en baie d’Aiguillon
à une demi-lieue de port Esnande.
Il fut recueilli par les habitants de la région et s’y
installa. Sans ressource, il décida de reprendre ses activités
habituelles, notamment la chasse aux oiseaux de mer. Des filets
étaient tendus sur le littoral entre des piquets de bois
enfoncés dans le sol. Le chasseur eut la surprise de constater
l’envahissement de ses poteaux par de nombreuses petites
moules dont il observa la rapide croissance.
Par la suite, il lui apparut plus profitable de capturer
des moules et de les engraisser plutôt que de chasser les
oiseaux. Il aurait de cette façon inventé les premiers
parcs à moules sur bouchots.
Longtemps, cette technique d'élevage sur bouchots ne s'est
pratiquée que sur la côte atlantique française,
région où le naissain se fixe naturellement sur
les pieux.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la population
vivaraise tenta la culture des moules selon différentes
méthodes (sur planches ou pierres), mais les résultats
n'étaient pas satisfaisants.
C'est en 1954, au Vivier sur mer, qu'est née la mytiliculture
en Baie du Mont-Saint-Michel. Cette nouvelle activité s'est
rapidement développée grâce à des conditions
de milieu tout à fait favorables
La mytiliculture sur bouchots est apparue sur la côte
est du Cotentin à partir de 1956. Mais c'est à partir
de 1963, sur la côte ouest, que cette culture va rapidement
se développer notamment dans les régions d’Agon
et de Pirou. En l'espace de 30 ans, la Normandie est devenue la
première région productrice de moules de bouchot
au monde.
retour
haut de page
|










